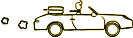Consommation d'énergie en Suisse : et la mobilité électrique dans
Le rôle que joue l'électricité dans la consommation globale d'énergie en Suisse.


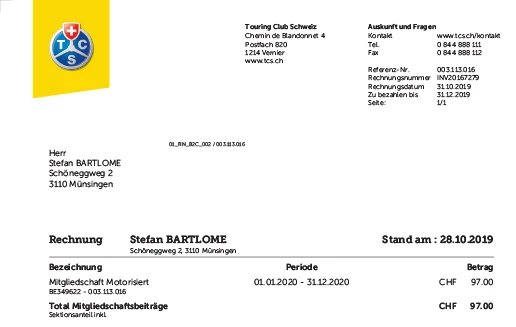
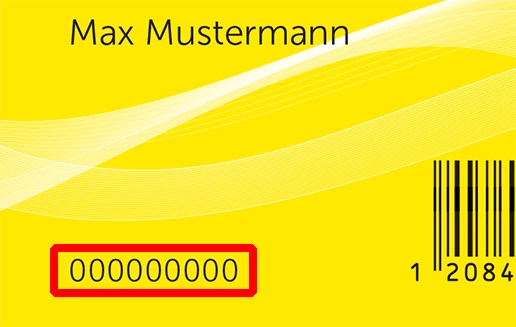
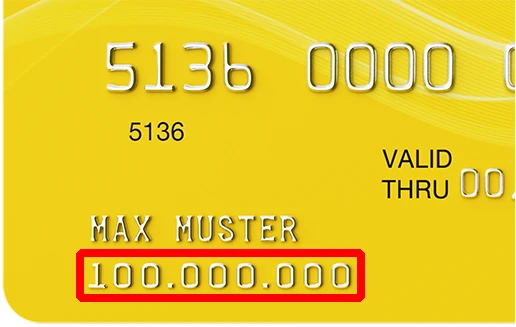
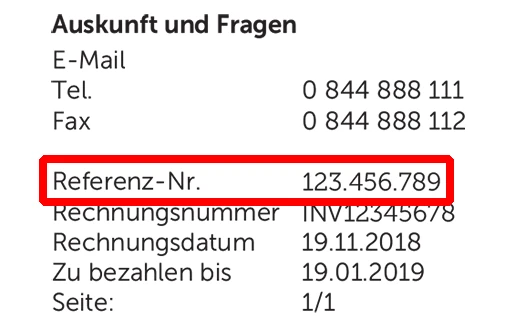

Découvrez les différentes possibilités de recharger votre véhicule électrique à domicile et ce dont il faut tenir compte. Informez-vous de plus sur la recharge avec l’électricité solaire et sur les autres tendances en matière de recharge. Bien entendu, le TCS se tient également à votre disposition à tout moment pour vous fournir des conseils indépendants.
La gamme de voitures électriques ne cesse de croître. SUV familial, break pratique, compacte agile ou coupé sportif, le TCS a testé pour vous les modèles actuels de manière neutre et compétente. Les dernières voitures électriques sont-elles vraiment performantes ?

Le réseau public de bornes de recharge en Suisse et en Europe s’étend en permanence. Néanmoins, nous vous recommandons de bien planifier un long trajet avec votre voiture électrique. Excursion à la montagne, voyage en Méditerranée ou à travers toute l’Europe, vous trouverez ici des informations utiles !

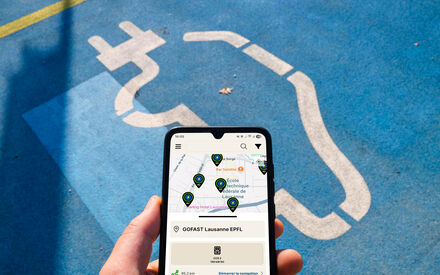
Quelle voiture électrique vous convient le mieux ? La recherche auto interactive et nos autres conseils sur l’achat d’une voiture électrique vous aident à vous décider. Grâce au TCS, vous restez à la page également en matière de tendances, de développements et de consommation d’énergie. Bonne route !


Même lorsque vous vous déplacez avec un véhicule électrique, le TCS est pour vous la meilleure assistance dépannage.
La helpline du TCS pour la mobilité électrique
Nos experts vous conseillent gratuitement en matière d'électromobilité.
058 827 80 80